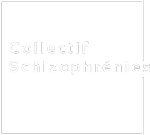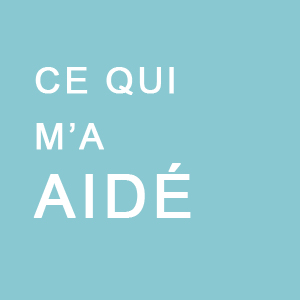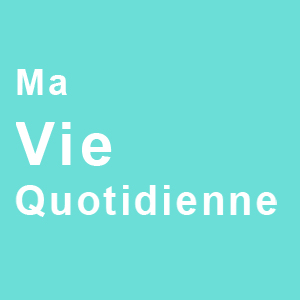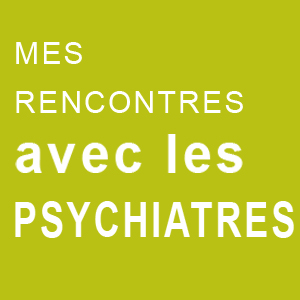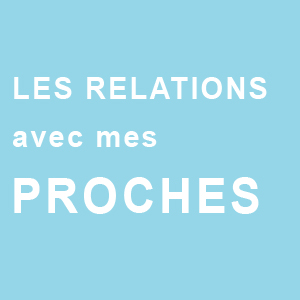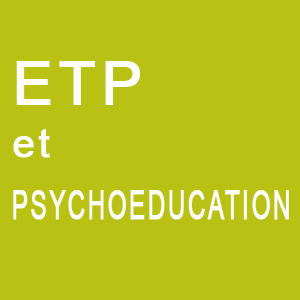Ils viennent dêtre confrontés aux troubles ou bien vivent avec depuis des années.
Tous ont souhaité apporter leurs témoignages au Collectif Schizophrénies pour mieux faire connaître au grand public ce qu'est la réalité de cette pathologie.
Leurs regards croisés permettent de donner une idée plus juste, plus précise et plus humaine de ces troubles si mal connus. Nous avons rassemblé ici, selon différents angles, comment ils vivent ou ont vécu les principales étapes de leur parcours.
L'intégralité des entretiens peut également être retrouvée sur la page suivante : Liste des témoignages
Cliquez sur chacune des vignettes pour accéder aux temps forts de chaque témoignage par thème : (rubriques en cours de construction)
Delphin entend des voix depuis plusieurs années. Il parle de la relation avec son psychiatre, de l'empathie et de l'écoute nécessaire des professionnels de santé et de l'importance de sa foi.
"Rien n'est impossible même si tout est fragile"
Florent Babillote était étudiant en droit quand il a été pris de bouffées délirantes. Il a raconté son entrée dans la schizophrénie dans "Obscur clarté". Aujourd'hui rétabli, il revient sur son parcours, ce qui l'a aidé, son métier d'aide-soignant et détaille l'histoire de son nouveau roman, "J'ai tendu la main".
Qu'est-ce qui vous a aidé durant votre parcours de rétablissement ? Votre famille, le monde hospitalier, le sport, l'écriture... ?
Plusieurs choses m’ont aidé. L’écriture de mon premier livre, « Obscure clarté », qui traite de mon histoire, et l’écriture en général. Ma famille m’a également beaucoup aidé, mon frère et ma sœur, je me suis rapproché de mon père, notamment. Le traitement adapté a aussi été utile. A la base, je suis quelqu’un de très actif, alors dormir vingt heures par jour pendant plusieurs mois, cela a été l’horreur. Dès que le traitement a été adapté, j’ai repris goût à la vie…Vous avez décidé devenir aide-soignant dans l'unité psychiatrique où vous avez vous-même été hospitalisé. Que pensez-vous apporter aux patients ?
Quand j’étais à la fac de droit, j’étais auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées, donc déjà sensibilisé au monde du handicap. Quand j’ai voulu changer de voie, aller vers le monde de la santé m’a semblé une évidence. Je me souvenais de l’équipe soignante qui avait été super avec moi et m’avait encouragé. De passer de soigné à soignant, je pense pouvoir apporter pas mal de choses avec un sentiment d’utilité, aussi. En fait, ce métier est une vocation. Je pense avoir de l’empathie et mon parcours leur donne beaucoup d’espoir.Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Suivez-vous toujours un traitement ?
J’ai le quotidien d’une personne normale qui est dû à un traitement adapté ; je ne prends plus qu’un comprimé par jour. Je sais que c’est un traitement à vie mais je le vis très bien. J’ai encore parfois des impatiences mais l’écriture m’a permis de maîtriser tout cela. J’ai appris à vivre avec la maladie. Je pense qu’il vaut mieux avoir quelques effets secondaires qu’on apprend, avec le temps, à maîtriser, qu’entendre des voix ou partir dans des délires dont, parfois, l’on ne revient pas.Ma schizophrénie est ma force, elle m’a apporté une force créative, peut-être plus d’ouverture sur le monde, m’a entraîné à ne plus être dans le jugement. Quand j’ai été malade, j’ai cru que ma vie s’arrêtait. Maintenant que je suis rétabli, je croque la vie à pleines dents.
Si j’avais un message à faire passer, ce serait que rien n’est impossible même si tout est fragile. Quand on est au fond du trou, il faut avoir la confiance du doute. On ne va pas être bien, on va être dépressif mais même là, il faut voir plus loin et se dire : « tu vas t’en sortir ». Quand j’étais interné, je me répétais sans arrêt cette phrase pour la faire mienne, y croire et, déjà, être dans l’action.Vous venez d'écrire un troisième livre qui s'appelle "J'ai tendu la main". Quelle est en est l'histoire ?
Elle commence de manière très simple. Un homme trouve un portable par terre dans une gare et cherche à découvrir qui l’a perdu. C’est un roman psychologique dont l’héroïne est une femme, Agathe, qui pour moi, est la muse parfaite. Elle est l’alliage subtil entre une grande force et une grande fragilité que rien ne peut faire sombrer. Je pense que de nombreuses femmes peuvent se reconnaître dans ce personnage.